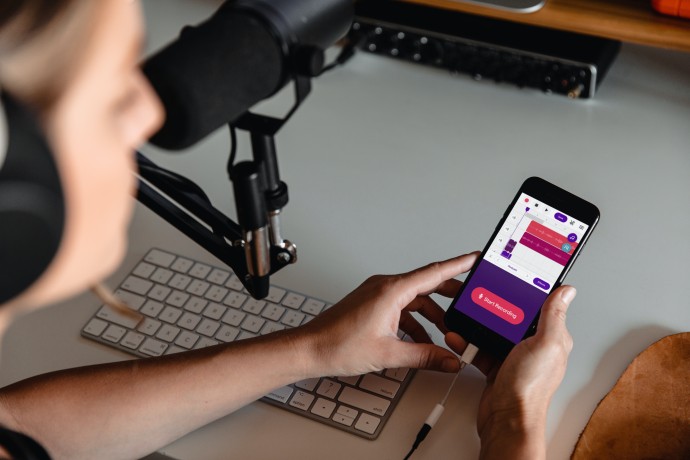La Belgique doit retrouver un trace moral

Les attentats ont exténué le Royaume. Pire, ils l’ont éreinté par une usure morale. Ces agressions nous confrontent avec de nouvelles réalités, comme l'écorce d'un arbre qui est arrachée en le mettant à vif. Certes, l’appareil de l’Etat et son exercice sont, par nature, incapable d’anticiper l’impensable. Mais, au-delà du courage et de l’abnégation inouïs dont font preuve ceux qui sécurisent ce pays et soignent les victimes de ces tragiques événements, il y a autre chose : nous sommes collectivement devenus inaptes à prendre de la hauteur. De nombreuses initiatives citoyennes démontrèrent une noblesse remarquable, mais chez d’autres, moins d’une semaine après le drame, tout ne fut que déchirements et surtout manque de sagesse, de retenue et de respect. Nous sommes immédiatement retombés dans un biais cognitif, c’est-à-dire une répétition de scénario, de fragmentation.
Si aucune souffrance ne doit être perdue, nous ressentons que quelque chose ne fonctionne plus dans ce pays. Est-ce un leurre, un tranquille naufrage ou bien un véritable supplice que seul le temps va effacer ? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine : nous avons vécu des rentes d’un passé glorieux, sans comprendre que la grandeur d’un pays exige une discipline, une certaine élévation de pensée et un projet partagé.
Où trouver l’origine de cette lente dérive de l’Etat ? Chacun aura un avis documenté sur la question, dont aucun historien n’arrivera à distinguer les faits de l’intuition.
Pourrait-elle être bien plus ancienne et profonde que des revendications contemporaines. J’en suis convaincu. Entourée de silences ou de confidences chuchotées, il y a une zone d’ombre dans l’histoire de notre pays. La plupart des mémorialistes la contourne avec embarras, comme si l’histoire était hantée par le néant. C’est la saison froide de la Belgique. Elle est lugubre : c’est la question royale où les deux communautés furent perdantes. Le régime fut désacralisé et mis au vote. La consultation populaire de 1950 le dépouilla d’un grand nombre de ses attributs régaliens pour transformer progressivement le pays en communautés et régions. Toute la transcendance originelle de la Belgique en fut ébranlée. Depuis, c’est une complexité institutionnelle qui se substitue à la lisibilité du tracé politique. Le pouvoir exécutif s’est fragmenté sous des couches de réformes qui eurent aussi comme conséquence d’entraîner l’immobilité sous une administration pesante. Singulièrement, la force de l’Etat repose peut-être sur l’impossibilité d’en désigner le détenteur.
Mais ce n’est pas tout : le pays s’est aussi désintégré économiquement dès avant son émiettement institutionnel. Au lieu de déployer une ambition, chaque mutation économique s’est accompagnée d’un effritement. Le déclin commença dans les années trente et s’accentua avec la désuétude progressive du charbon et de l’acier, couplée à l’indépendance des colonies. Des trente années glorieuses (1944-1974), seules quelques-unes, encadrant l’exposition universelle de 1958, furent illustres. En plein cœur des années septante, qui furent une décennie maudite, le pays entama sa régionalisation au prix du maintien de secteurs nationaux qui étaient rendus surannés au moment même de leur désignation. On se déchira sur les Fourons pendant qu’un basculement économique engloutissait l’économie manufacturière. Plus tard, l’affaire de la Générale noya le quart du PIB dans un chaotique sabordage. Dix ans plus tard, la moitié du BEL-20 passa sous actionnariat étranger tandis que la crise de 2008 mit le secteur bancaire à genoux.
Socialement, aussi, les choses se sont gravement dégradées. Certes, les trente glorieuses furent plutôt l’exception que la norme en termes de configuration socio-politique. Il n’empêche qu’elles fondèrent la cohésion sociale sur le respect du travail et l’envie d’un projet de société commun basé sur l’entrepreneuriat et la redistribution. Aujourd’hui, la classe moyenne s’étiole et la pauvreté s’infiltre alors que le tourbillon de la révolution numérique va pulvériser des pans entiers de notre économie. La quantité et la qualité de travail vont diminuer. Dans ce domaine, l’Etat reste muet alors que l’économie de marché spontanée ne permettra pas de financer nos engagements collectifs. Les prochaines années vont révéler une terrible confrontation et sans doute une colère sociale de certaines classes défavorisées. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas minimiser les risques de radicalisation et d’extrémismes politiques. Les crises économiques entraînent des éruptions et les escalades politiques sont une lave qui n’est jamais refroidie
Et puis, des défis sociétaux d’une envergure tectonique nous attendent. Nous avons, en grande partie, échoué à intégrer des populations immigrées ou de confessions religieuses différentes alors que des vagues de migrations successives, d’origine politique, économique ou climatique, sont certaines. A la périphérie de l’Europe, des frontières se ferment et des régimes renouent avec l’esprit des années trente. La guerre se diffuse à l’Est et au Sud. Au-delà des premières réactions de répression et d’exclusion, qu’allons-nous faire ? Sans un message politique clair sur la cohésion sociale, nous allons diviser architecturalement nos villes et quartiers, avant de redéfinir les pays et les frontières. Ou irons-nous? Où sera l’envie du futur ?
Depuis 2008, toutes les crises se mélangent et se conjuguent pour s’amplifier. Or ces crises sont un avertissement sévère tant à la société civile qu’à nos gouvernants, et surtout à nous-mêmes. C’est d’ailleurs peut-être davantage qu’un avertissement, un passage vers une prise de conscience de mondes nouveaux. Dans le Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline aurait pu transposer aux ruptures sociétales son pressentiment que c'est peut-être cela qu'on cherche à travers la vie, rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir.
La véritable question portera sur la représentation de l'avenir du corps social car les configurations sociétales deviennent extrêmement vulnérables. Les démocraties seront mises à l'épreuve dans le sillage des chocs économiques. Insidieusement, d'autres configurations politiques risquent d'émerger. Nos temps révèlent d’ailleurs une fin de modèle. La fin d'un modèle de complaisance, de manque de vision, de déficit de perspectives. Le moment est venu de poser la question des temps nouveaux et de constater qu'un univers moderne se dresse, sans qu'on l'ait pressenti, ni conjuré. Cet univers reste à réinventer.
L’absurdité des événements n’apparait que si nous les jugeons à l’aune du temps court. S’il y a des périodes politiques, il faut désormais un temps étatique. Il convient de retrouver un tracé moral. Il faut un Etat et des régions forts, non pas au sens de l’autoritarisme qu’ils peuvent exercer, mais de l’autorité qui peut en rayonner. Il faut, avant tout, un Etat qui rassure. Mais aucune solution institutionnelle consensuelle ne pourra y contribuer car ce qui importe, c’est de créer un éthos de confiance, c’est-à-dire une vision longue qui promulgue la cohésion sociale, la solidarité politique et la bienveillance économique. C’est donc dans des valeurs morales, intégrées et respectées, que se trouve la solution. Ces valeurs partagées sont la solidarité et le respect de l’autre. C’est surtout et d’abord l’instruction publique et civique. Ce sera un travail permanent car des valeurs se construisent plus qu’elles ne se postulent.
Je dois beaucoup à ce pays, à commencer par l’éducation, tout en tentant de rendre ce qui m’’est donné. Je garde une foi indestructible et une conviction absolue qu’il finira par se ressaisir devant les grands périls qui le menacent.
Mais, aujourd’hui, l’Etat suscite l’indécision et même parfois l’inquiétude. A terme, tous, quelles que soient les configurations politiques futures, nous en serons perdants. Je crois que l’engagement citoyen et individuel ne suffit pas. Il est indispensable que, faute d’homme providentiel, ceux qui dirigent l’Etat indiquent, au risque de l’impopularité, quel est son avenir social et politique dans un cadre moral apaisant. Le pays manque de lisibilité sur son avenir, quel qu’il soit. En transposant à un pays ce qu’il appliquait à l’homme, c’est peut-être François Mauriac qui avait raison quand il affirmait que « notre vie vaut ce qu’elle a coûté d’efforts ».
Cet article est rédigé à titre personnel et n’engage aucunement les institutions auxquelles l’auteur est affilié.